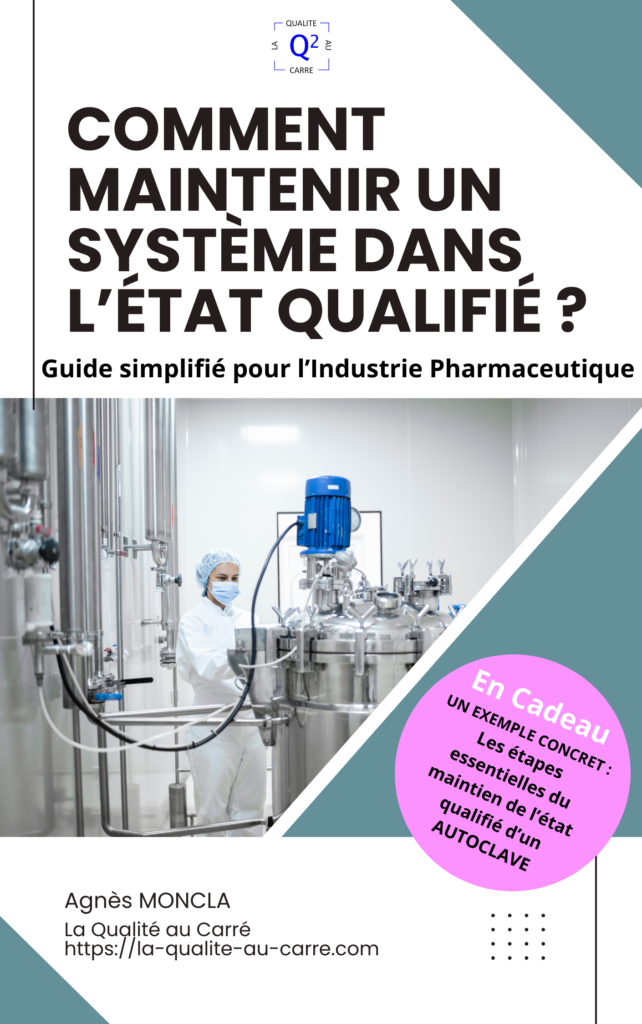Les médicaments ne sont pas seulement définis par leur nom commercial ou leur effet. Ils se classent selon plusieurs critères : origine, mode d’action, forme galénique et voie d’administration. Comprendre la classification des médicaments permet de mieux appréhender la réglementation associée.
Cette synthèse des principaux classements de médicaments, vous aide à y voir plus clair.
Sommaire
Par origine et méthode de fabrication
Les médicaments peuvent être classés selon leur mode de production ou leur origine :
- Médicaments chimiques : issus de la synthèse chimique industrielle, ce sont les plus anciens et les plus nombreux sur le marché (ex. : paracétamol, ibuprofène).
- Médicaments biologiques : fabriqués à partir d’organismes vivants (cellules, protéines, gènes). Exemples : anticorps monoclonaux, vaccins, thérapies cellulaires et géniques.
- Médicaments à base de plantes (phytothérapie) : utilisent des extraits de plantes pour leurs propriétés thérapeutiques.
- Médicaments homéopathiques : préparés à partir de substances actives très fortement diluées selon un protocole spécifique.
Par classe thérapeutique (effet et cible)
Cette classification permet d’identifier les médicaments selon l’effet qu’ils produisent ou la maladie qu’ils ciblent. Voici un aperçu des grandes familles :
- Analgésiques : traitement de la douleur, d’action périphérique ou centrale, antispasmodiques.
- Antibiotiques : traitement des infections bactériennes (bêta-lactamines, aminosides, macrolides, tétracyclines, quinolones, sulfamides, etc).
- Anticoagulants : empêchent la formation de caillots sanguins.
- Antidépresseurs : utilisés contre la dépression.
- Antidiabétiques : insulines, sulfamidés hypoglycémiants, guanidines.
- Antifongiques : contre les infections fongiques, à usage local, systémique ou gynécologique.
- Anti-inflammatoires : stéroïdiens (corticoïdes) ou non stéroïdiens (AINS).
- Antihistaminiques : traitement des allergies.
- Antihypertenseurs : contrôle de la tension artérielle (bêta-bloquants, diurétiques, inhibiteurs calciques, sartans, etc).
- Antipaludéens : contre le paludisme.
- Antipsychotiques : pour les troubles psychiatriques.
- Antiviraux : contre les infections virales, dont les antirétroviraux pour le VIH.
- Bronchodilatateurs : traitement de l’asthme, de la BPCO.
- Chimiothérapies : traitement des cancers.
- Corticostéroïdes : puissants anti-inflammatoires.
- Diurétiques : favorisent l’élimination de l’eau par les urines.
- Immunosuppresseurs : prévention du rejet de greffe ou traitement des maladies auto-immunes.
- Vaccins : prévention des maladies infectieuses.
Cette liste n’est pas exhaustive. Chaque classe peut comporter plusieurs sous-familles et principes actifs.
Par forme galénique
La forme galénique désigne la présentation du médicament, c’est-à-dire comment il est conçu pour être administré.
Les principales formes sont :
- Orale : administrée par la bouche (comprimés, gélules, pastille, sirops, suspensions, solutions buvables).
- Dermique : appliquée sur la peau (crèmes, pommades, gels, patchs transdermiques).
- Injectable : administrée par injection (intraveineuse, intramusculaire, intradermique, sous-cutanée).
- Rectale : introduite par le rectum (suppositoires, pommade).
- Vaginale : introduite par le vagin (ovules, capsules, comprimés vaginaux).
- Inhalée : administrée par aérosols (sprays, poudres pour inhalation).
- Nasales / Ophtalmique / auriculaire : administrées par le nez, les yeux, les oreilles (collyre, gouttes ou spray pour le nez, les yeux ou les oreilles).
Chaque forme est adaptée à un usage spécifique et influe sur la rapidité d’action, l’absorption et le confort du patient.
Par voie d’administration
La voie d’administration correspond à la méthode utilisée pour introduire le médicament dans l’organisme.
- Voie entérale : passage par le tube digestif (bouche, rectum, sonde)
- Voie parentérale : administration en dehors du tube digestif (injection directe (veine, muscle, sous cutanée, …))
- Voie cutanée ou transdermique : passage par la peau (forme dermique)
- Voie transmucosale : passage par les muqueuses (nasale, vaginale, oculaire, pulmonaire …).
La voie d’administration est choisie dès le développement du médicament, en fonction de celle qui offre la meilleure efficacité, la plus grande rapidité d’action ou le moindre impact invasif, selon les besoins cliniques.
Conclusion
Classer les médicaments, est utile d’un point de vue réglementaire, thérapeutique et logistique. Chaque médicament peut être identifié selon plusieurs axes : origine, cible thérapeutique, forme galénique, et voie d’administration. Ces classifications ne s’excluent pas, elles se complètent. Un même médicament peut donc appartenir simultanément à plusieurs catégories.
Prenons l’exemple de l’amoxicilline : c’est un médicament chimique, de la classe des antibiotiques bêta-lactamines, administré par voie orale, sous forme de gélule ou suspension buvable.
Ces classifications croisées permettent de structurer l’information produit, de faciliter la prescription, de garantir la traçabilité tout au long du cycle de vie du médicament, et de répondre aux exigences qualité en matière de sécurité, d’identification, de conformité et de gestion du risque.
Comprendre la classification des médicaments, c’est mieux anticiper les exigences normatives, sécuriser la production, et renforcer la qualité du médicament à chaque étape de sa vie.
Cet article vous a plu, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou à le partager.
Vous pourriez également être intéressé(e) par l’article suivant:
Processus de mise sur le marché d’un médicament : les différentes phases
Questions fréquentes
Q1 : Qu’est-ce que la classification ATC et le code CIP 13 ?
La classification ATC et le code CIP 13 sont deux systèmes utilisés en France pour identifier et organiser les médicaments de manière normalisée.
🔹 Classification ATC (Anatomique, Thérapeutique, Chimique)
La classification ATC (anatomique, thérapeutique et chimique) est un système international mis en place par l’OMS pour classer les médicaments selon :
- L’organe ou le système ciblé,
- Leur action thérapeutique,
- Leur composition chimique.
Chaque médicament reçoit un code ATC à 7 caractères
C’est le Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de l’OMS qui le contrôle.
Chaque code ATC se divise en 5 niveaux qui sont définis sur le site de l’OMS :
- ATC1 (groupe principal anatomique) ;
- ATC2 (sous-groupe thérapeutique) ;
- ATC3 (sous-groupe pharmacologique) ;
- ATC4 (sous-groupe chimique) ;
- ATC5 (sous-groupe substance chimique).
Exemple : C09AA05
- C → Système cardiovasculaire (niveau anatomique)
- 09 → Agents agissant sur le système rénine-angiotensine (thérapeutique)
- A → Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
- A → Inhibiteurs de l’ECA simples
- 05 → Enalapril (substance spécifique)
Pour plus de détails : Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification – OMS
🔹 Code CIP 13 (Code Identifiant de Présentation)
Le code CIP 13 ou « code identifiant de présentation » est un code à 13 chiffres utilisé en France pour identifier chaque présentation précise d’un médicament (forme, dosage, conditionnement).
Ce code est attribué par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
La structure du code CIP 13 est la suivante :
- Les 4 premiers chiffres sont toujours 3400 : Préfixe médicament France
- Les règles concernant les 8 chiffres suivants sont complexes et dépendent du type de médicament :
- pour un médicament allopathique auquel a été affecté préalablement un nombre à 7 chiffres (CIP7), on fait précéder ces 7 chiffres du chiffre 9
- pour un médicament homéopathique auquel a été affecté préalablement un nombre à 7 chiffres (CIP7), on fait suivre ces 7 chiffres d’un chiffre propre au fabriquant
- pour un médicament autorisé depuis le 1er janvier 2009, les huit chiffres sont délivrés par l’administration autorisant la mise sur le marché.
- Le 13e et dernier chiffre est une clé de contrôle calculée selon la formule de Luhn basée sur les 12 premiers chiffres.
Pour aller plus loin :