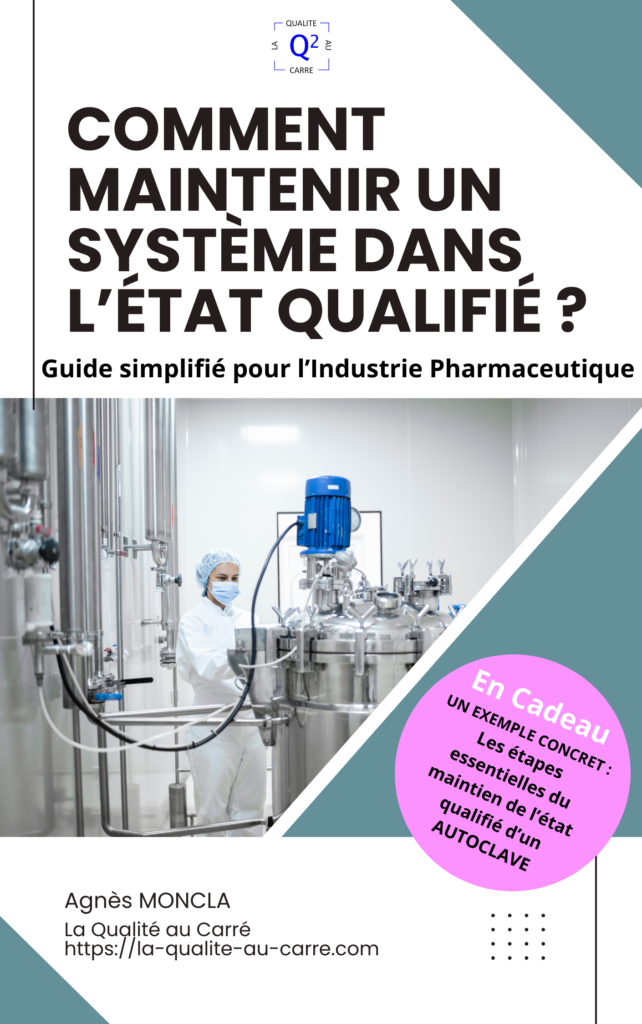Dans cet article nous allons explorer comment qualifier un réfrigérateur, un congélateur, une étuve, un incubateur, une chambre froide ou une enceinte de stabilité, … bref une enceinte thermostatique ou climatique.
Nous commencerons par revoir quelques définitions, puis nous enchainerons par les besoins utilisateurs qui sont à définir si vous achetez un appareil neuf, puis nous balaierons la liste des tests minimums à réaliser lors de la qualification d’une enceinte climatique utilisée en milieu pharmaceutique.
Prêt ? C’est parti.
Sommaire
Définitions et types d’enceintes
Tout d’abord, commençons par quelques définitions. Pourquoi le titre de cet article est qualification d’une enceinte thermostatique ou climatique ? Tout simplement car celui-ci est un terme générique qui permet de regrouper plusieurs équipements que l’on retrouve dans nos entreprises ! Et lorsque l’on a identifié ce point, cela permet de simplifier sa documentation, gagner du temps lors de la qualification en rendant possible la rédaction d’une analyse de risque qui regroupera plusieurs équipements par exemple, ou l’utilisation d’un protocole unique que l’on exécutera pour chaque équipement !
Ok, cela semble intéressant mais quels sont les éléments que l’on peut regrouper ? autrement dit, qu’est-ce qu’une enceinte ?
Qu’est-ce qu’une enceinte ?
Une enceinte est un espace clos dans lequel un ou plusieurs paramètres d’environnement sont contrôlés (température, humidité, etc.).
Quelle est la différence entre enceinte thermostatique et climatique ?
Les chambres ou enceintes :
- thermostatiques sont des volumes dans lesquels la température de l’air est contrôlée ;
- climatiques sont des volumes dans lesquels la température et l’humidité relative de l’air sont contrôlées.
Note : Les enceintes climatiques peuvent aussi parfois réguler la pression, les vibrations, l’intensité de lumière, la teneur en CO2, … en fonction de leur utilisation.
Qu’est-ce qu’une enceinte à compartiment ?
Une enceinte à compartiments est une enceinte ayant au moins 2 volumes séparés limitant ou annulant la circulation de l’air entre eux.
Note : Ces trois définitions sont issues du fascicule documentaire FD X15-140 (août 2024).
Quelques exemples d’enceintes thermostatiques
Les enceintes thermostatiques couramment utilisées dans l’industrie pharmaceutique sont les suivantes :
- les congélateurs ;
- les réfrigérateurs et armoires frigorifiques ;
- les étuves ;
- les incubateurs ;
- les zones de stockage ou de production à température contrôlée ;
- les chambres froides ;
- etc.
Quelques exemples d’enceintes climatiques
Les enceintes climatiques couramment utilisées dans l’industrie pharmaceutique sont les suivantes :
- les enceintes de stabilité ;
- les enceintes de vieillissement accéléré
- les zones de stockage ou de production à température et humidité contrôlées
- etc.
Enceintes Thermostatiques / Climatiques : Principe de fonctionnement
Description technique d’une enceinte
Les enceintes thermostatiques et climatiques sont des équipements conçus pour réguler précisément la température et, pour certaines, l’humidité. La performance de ces enceintes est déterminée par la capacité à maintenir des conditions constantes à l’intérieur de l’enceinte, même en cas de perturbation (ouverture de porte, changement de charge, etc.).
Elles sont généralement composées de :
- une enveloppe extérieure : d’ordinaire en acier inoxydable ou en matériaux résistants à la corrosion pour assurer une longue durée de vie ;
- un isolant thermique : couramment des mousses ou de matériaux isolants haute performance, souvent sans CFC ou HCFC pour répondre aux normes environnementales. Cette isolation est essentielle pour stabiliser la température interne ;
- une ou plusieurs porte(s) : équipée(s) de joints hermétiques pour minimiser les échanges d’air avec l’extérieur. Certains modèles intègrent des portes vitrées ou à hublot pour visualiser l’intérieur sans perturber les conditions environnementales ;
- des étagères ou grilles réglables ;
- quatre roues ou pieds
- un système de régulation thermique composé d’un élément chauffant souvent des résistances électriques avec un système de ventilation (pour garantir l’homogénéité)
- un système de réfrigération (pour les enceintes climatiques et certaines enceintes thermostatiques comme les réfrigérateurs ou congélateurs) composé d’un groupe froid (compresseur, évaporateur, et condenseur) pour abaisser et maintenir la température. Ce système doit utiliser un gaz réfrigérant exempt de CFC afin de se conformer aux normes environnementales ;
- un système de contrôle de l’humidité (pour les enceintes climatiques uniquement) : humidificateur (la plupart du temps un système de vaporisation d’eau distillée), déshumidificateur (circuit frigorifique ou dessicant) ;
- un système de régulation et de contrôle : (souvent composé de capteurs de température et d’humidité, d’un microprocesseur programmable qui permet de définir des consignes et des seuils de température et d’humidité et d’un enregistreur de données afin d’assurer la traçabilité des mesures en continu avec un écran et une connexion à un ordinateur ou le réseau) ;
- un système d’alarmes : habituellement alarmes sonores et visuelles dans le local ou surveillance à distance via une interface informatique : Déclenchées en cas de dépassement des seuils de température ou d’humidité définis (seuils haut et bas). Cela permet d’intervenir rapidement en cas de problème ;
- un système de redondance : pour assurer le maintien des conditions environnementales critiques même en cas de défaillance technique (onduleur, second groupe froid) ;
- un système de verrouillage de la porte, si nécessaire ;
- un passage de câbles : orifice intégré pour permettre l’installation de sondes supplémentaires ou d’appareils de test à l’intérieur sans perturber l’étanchéité thermique ou climatique.
Paramètres contrôlés dans une enceinte
Les principaux paramètres contrôlés sont :
- Température ;
- Humidité relative (pour les enceintes climatiques).
Spécification des besoins utilisateurs (URS)
Avant l’achat d’une enceinte, il est important de définir les besoins utilisateurs (SBU ou URS).
- Type d’enceinte :
- Thermostatique (régulation de la température) ou climatique (régulation de la température et de l’humidité)
- Conditions d’utilisation de l’enceinte :
- plage de température et précision
- plage d’humidité et précision (si enceinte climatique)
- Caractéristiques de l’enceinte :
- matériaux de construction (intérieur / extérieur) ;
- isolant sans CFC et HCFC par exemple ;
- capacité de l’enceinte :
- volume
- étagères ou grilles : nombre, réglable en hauteur et amovibles pour faciliter le nettoyage / matériau ;
- charge maximale autorisée par étagères / grille ;
- – type de ventilation (naturelle ou avec ventilation d’air forcée) ;
- – éclairage ;
- – porte d’accès (nécessité d’un hublot d’inspection ? d’un système de fermeture sécurisé ?)
- – roues pivotantes / antistatiques ou pieds réglables.
- Système de contrôle et d’alarme :
- Contrôleur et enregistreur (consigne / visualisation et enregistrement de la température et de l’humidité en temps réel / enregistrement de l’ouverture de porte et du temps d’ouverture, …)
- Alarmes sonore et visuelle de température et d’humidités hautes et basses (idéalement 2 seuils) en local et / ou surveillance à distance
- Caractéristiques électriques : tension, fréquence
- Aménagement spécifique attendu :
- Par exemple :
- Accès facile aux pièces de l’enceinte nécessitant une maintenance ou une vérification métrologique
- Orifice pour le passage des câbles pour les tests et son bouchon
- Réservoir d’eau distillée avec accès facile pour le système d’humidification (implantation pour position pour un accès facile)
- Système de redondance : onduleur ou deuxième groupe froid
- Par exemple :
- Contraintes du projet : par exemple s’il existe des contraintes dans le local où l’on souhaite installer l’enceinte :
- Dimensions extérieures maximales (Largeur / profondeur / hauteur)
- Distance paroi arrière / parois latérales
- Poids max de l’équipement à vide
- Niveau sonore maximal si nécessaire
- Exigences spécifiques : par exemple : système de régulation CO2, ou éclairage conforme à l’ICH Q1B si la chambre est utilisée pour des essai de vieillissement accéléré, …
Sans oublier, la documentation fournisseur attendue, les exigences relatives au système informatisé si l’enceinte en est équipée, les exigences réglementaires auxquelles l’enceinte doit répondre, la formation des utilisateurs attendue.
Pour plus de détails sur la rédaction des Spécifications des Besoins des Utilisateurs, je vous invite à consulter :
- l’article dédié aux Spécifications des Besoins Utilisateurs (SBU / URS) qui explique en détail ce qu’est un URS, l’importance d’écrire des Spécifications des Besoins Utilisateurs, et qui vous propose un plan pour la rédaction d’un URS.
- ou l’article présentant un exemple concret d’URS appliqué à un réacteur.
Processus de Qualification
Qualification de Conception (QC)
La revue de qualification de conception garantit et documente que l’enceinte est conçue selon les besoins de l’utilisateur (URS) et répond aux exigences de qualité et de performance, ainsi qu’aux requis réglementaires.
Analyse de risque
Une fois le choix de l’enceinte effectué, il sera nécessaire de rédiger une analyse de risque afin d’identifier les aspects critiques (composants et fonctions) susceptibles d’affecter la performance et la fiabilité de l’enceinte, ce qui permettra de déterminer l’effort de qualification requis.
FAT et SAT
Pour ce type d’équipements, souvent standards (équipements simples non personnalisés disponibles sur catalogue), les tests FAT et SAT ne sont généralement pas effectués. Cette absence est justifiée et documentée soit dans le Plan de Validation du site, soit dans le plan de qualification de l’équipement.
Qualification d’Installation (QI)
La qualification d’installation vérifie que l’enceinte est installée correctement et en conformité avec les spécifications techniques. Cela inclut :
- Vérification de l’état général de l’enceinte : Inspection visuelle de la propreté, de l’absence de rayure, de tache, de corrosion, de choc, fissure, …) des surfaces extérieures, intérieures et du joint de porte ;
- Vérification des caractéristiques de l’enceinte (modèle, n° de série, dimensions, matériaux, …) et de la présence de tous les éléments attendus (nombre d’étagères, câble d’alimentation, orifice du passage de câble pour les tests et emplacement correcte, clefs de la porte …)
- Vérification de la documentation livrée par le fournisseur (manuel d’utilisation, de maintenance, certificat d’étalonnage des instruments de mesure, fiche technique des différents composants, certificat matière si nécessaire, …) ;
- Vérification du raccordement aux utilités (réseau électrique, circuit d’eau adoucie ou purifiée si nécessaire, …)
- Vérification de l’installation (planéité, accès au éléments (bac d’eau distillé, sonde de température et d’humidité, …) et de l’état de fonctionnement des composants (interrupteur, voyant, éclairage, enregistreur, l’interface homme / machine (IHM)) ;
- Vérification des dispositifs de sécurité si existant.
Qualification Opérationnelle (QO)
La qualification opérationnelle valide le bon fonctionnement de l’enceinte à vide. Parmi les tests minimums à réaliser, on retrouve la :
- Vérification du bon fonctionnement des alarmes et leur report ;
- Vérification de la gestion des accès, des vues d’écran de l’IHM, des sauvegardes des données, de l’impression des données, de l’audit trail si un système informatisé ou automatisé est présent ;
- Vérification métrologique des instruments de mesures ;
- Vérification de la température et de l’humidité en régime établi :
- Homogénéité spatiale
- Stabilité temporelle
- Écart de consigne
- Vérification en marche dégradée :
- Test d’inertie (temps de maintien des conditions environnementales de l’enceinte après une coupure d’alimentation électrique ou un arrêt de groupe froid) ;
- Test du temps de récupération de la température et de l’humidité après une perturbation (essai d’ouverture de porte ou coupure d’alimentation électrique ou arrêt de groupe froid)
- Test de backup ou redondance (vérification de l’activation du système d’alimentation de secours (onduleur ou générateur) et / ou vérification de la prise de relais automatique du 2e groupe froid si le système principal tombe en panne)
Cette liste n’est pas exhaustive, elle doit être adaptée en fonction des conclusions de l’analyse de risque réalisée pour votre équipement et votre utilisation.
Définition : écart de consigne : différence entre la valeur moyenne de chaque paramètre d’environnement mesuré dans l’espace de travail et la valeur de consigne.
Qualification de Performance (QP)
La Qualification de performance évalue la performance de l’enceinte en charge, c’est-à-dire avec des produits représentatifs de son utilisation. Cela permet de tester l’impact de la charge sur l’homogénéité de la température et de l’humidité.
Les mêmes tests que ceux réalisé en qualification opérationnelle (homogénéité, stabilité, écart de consigne en régime établi ainsi que les tests d’inertie et de temps de récupération) seront réalisés mais on aura pris le soin au préalable de remplir l’enceinte avec des spécimens représentatifs de la charge réelle (par exemple des bouteilles d’eau ou des cartons vides, …).
Attention pensé à adapter les spécimens utilisés à ceux représentatifs de la charge réelle ! En particulier utiliser des spécimens non dissipant ou dissipant de l’énergie en fonction de l’utilisation future de votre enceinte.
Note : Un spécimen dissipant est un objet qui, lorsqu’il est placé dans une enceinte thermostatique ou climatique, dégage de l’énergie, généralement sous forme de chaleur. À l’inverse, un spécimen non dissipant ne produit pas ou très peu de chaleur et ne contribue pas de manière significative à l’augmentation de la température dans l’enceinte.
Exemple : Lorsque vous placez un contenant rempli d’eau à 20°C dans un congélateur, ce contenant est considéré comme un spécimen dissipant, car il libérera de la chaleur dans l’enceinte. En revanche, si ce même contenant est déjà congelé avant d’être mis dans le congélateur, il sera considéré comme un spécimen non-dissipant, puisqu’il n’apportera pas de chaleur à l’intérieur du congélateur.
Qualification périodique
La qualification périodique permet de s’assurer que l’enceinte conserve ses performances au fil du temps. Elle inclus des tests similaires à ceux de la QO et de la QP, réalisés à intervalles réguliers.
Conclusion
En résumé, la qualification d’une enceinte thermostatique / climatique nécessite vérifiera :
- L’homogénéité de la température et de l’humidité dans tout le volume de l’enceinte ;
- La stabilité dans le temps ;
- L’écart par rapport à la consigne
- Le temps de récupération après ouverture de porte
- La redondance et les sytèmes de backup en cas de panne
Ces tests doivent être ajustés en fonction des résultats de l’analyse de risque pour garantir la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Cet article vous a plu, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou à le partager.
Questions fréquentes :
Q1 : Qu’est-ce que le régime établi ?
Le régime établi est atteint lorsque la valeurs moyenne (température et / ou humidité) est constante.
Le régime établi est l’état atteint par l’environnement quand les écarts, entre les valeurs de chaque point de l’espace de travail et la valeur de consigne sont stabilisés pour chacun des paramètres d’environnement.
Q2 : Combien te temps je dois laisser la porte ouverte lors de l’essai d’ouverture de porte ?
Dans le cas d’une ouverture de porte, le temps d’ouverture est d’une minute avec une ouverture totale (sauf spécifications particulières), selon le fascicule documentaire FD X15-140, paragraphe 8.9 temps de récupération de la température
Le temps de chargement et de déchargement d’une enceinte thermostatique ou climatique doit toujours être le plus court possible. C’est pourquoi il est important de ranger méthodiquement et de bien identifier où sont ranger les produits.
Ce que j’ai beaucoup vu, c’est de définir dans le protocole un temps correspondant au temps de chargement ou de déchargement de l’enceinte lorsque l’on met ou l’on sort des produits dans l’enceinte (entre 1 à 5 minutes)
Le temps est compté à partir de la fin de la perturbation volontaire.
Q3 : Qu’est-ce qui change entre la version de 2013 et celle de 2024 du fascicule documentaire FD X 15-140 ?
Les principales modifications entre les versions de mai 2013 et d’août 2024 du fascicule FD X 15-140 concernent :
- Le titre de la norme : dans la version 2014 apparait le terme surveillance
- Le domaine d’application a été élargie :
- Plage de température : -200°C < Température < +600°C
- Plage d’humidité : 0% < Humidité relative < 100% pour une température de 0°C à 100°C
(La version de 2013 ne couvrait que la plage de température -100°C < Température < +600°)
- Le paragraphe concernant les références normatives a été réduit. Dans la version 2024, seuls trois documents de référence normatifs sont mentionnés.
- La définition d’une enceinte à compartiments a été ajoutée
- Le nombre de capteurs à utiliser lors des cartographies a été modifié comme suit :
- Version 2013 :
- volume inférieur ou égal à 2 m3 : 9 capteurs
- volume supérieur à 2 m3 et inférieur ou égal à 20 m3 : 15 capteurs
- autres volume : nombre de capteurs à justifier
- Version 2024 :
- volume inférieur ou égal à 0,085 m3 : minimum 5 capteurs
- volume supérieur à 0,085 m3 et inférieur ou égal à 1 m3 : 9 capteurs
- volume supérieur à 1 m3 et inférieur ou égal à 10 m3 : 15 capteurs
- volume supérieur à 10 m3 : minimum 15 capteurs
- Enceinte compartimentée : dépend du nombre de compartiments
- Version 2013 :
- L’ajout d’un nouveau chapitre (17 – Surveillance d’une enceinte).
- L’annexe A qui était à caractère informatif en 2013, est devenue normative en 2024. Elle porte sur le calcul de l’écart maximal de la valeur de l’humidité relative en fonction de différentes EMT (Erreurs Maximales de Température).
- L’ajout de 4 nouvelles annexes :
- Annexe F (informative) Exemples d’instrumentations d’enceintes à compartiments.
- Annexe G (informative) Exemple de caractérisation en régime établi en température et humidité
- Annexe H (informative) Surveillance d’une enceinte
- Annexe I (informative) Description des méthodes d’estimation de l’effet de rayonnement des parois sur les sondes de température
Sommaire du fascicule de documentation
FD X15-140
Mesure de l’humidité de l’air – Enceintes climatiques et thermostatiques – Caractérisation, vérification et surveillance
– Août 2024 –

Documents de référence
- FD X15-140 Mesure de l’humidité de l’air – Enceintes climatiques et thermostatiques – Caractérisation, vérification et surveillance (août 2024)
- NF EN IEC 60068-3-5 : Essais d’environnement – Partie 3-5 : Documentation d’accompagnement et guide – Confirmation des performances des chambres d’essai en température (mars 2018)
- NF EN IEC 60068-3-6 : Essais d’environnement – Partie 3-6 : documentation d’accompagnement et guide – Confirmation des performances des chambres d’essais en température/humidité (mars 2018)
- NF EN IEC 60068-3-7 : Essais d’environnement – Partie 3-7 : documentation d’accompagnement et guide – Mesures dans les chambres d’essai en température pour les essais A (froid) et B (chaleur sèche) (avec charge) (août 2020)
- NF EN 60068-3-11 : Essais d’environnement – Partie 3-11 : documentation d’accompagnement et guide – Calcul de l’incertitude des conditions en chambres d’essais climatiques (août 2007)
- NF EN ISO/IEC 17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (décembre 2017)
- FD V08-601 Microbiologie des aliments – Enceintes thermostatiques – Caractérisation, vérification et suivi quotidien (février 2005)
- DIN 12880 Appareils de laboratoire électriques – Etuves armoire et étuves à incubation (mai 2007)
- Eudralex volume 4 (GMP guidelines),
- Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et plus particulièrement :
- l’annexe 15 : Qualification et Validation
- l’annexe 11 : Systèmes Informatisés
- STP Pharma Pratiques – volume 21 n°3 – mai-juin 2011
Acronyme / Abréviations / Glossaire
FAT : Factory Acceptance Tests (Tests d’acceptation en usine)
HR : Humidité relative
QI : Qualification de l’Installation
QO : Qualification Opérationnelle
QP : Qualification des Performances
SAT : Site Acceptance Tests (Tests d’acceptation du site)
SBU : Spécification des Besoins Utilisateurs
URS : User Requirements Specifications
Image par Hasan Serdal Köksal de Pixabay